|
Le site de Capdenac
se présente comme un éperon barré. De toutes parts ce formidable
promontoire rocheux est défendu de falaises abruptes dominant de 120
mètres la rivière Lot qui forme une boucle à ses pieds. Grâce à toutes
ses défenses naturelles, Capdenac fut choisi comme refuge par les
hommes, depuis les temps les plus anciens (plus de 3.000 ans av J.C.).
Capdenac fut en effet certainement un des premiers oppida du Lot à
bénéficier de fortifications.
Le site de Capdenac
ne présente qu’un seul point faible, une bande de terre d’une centaine
de mètres qui relie la partie où se trouve le village, au reste du
plateau. C’est donc ce point faible que les divers défenseurs du site
s’appliqueront à défendre chacun à leur manière, tout au long des
siècles, pour aboutir au système très élaboré qui fut mis en place au
XIVème siècle.
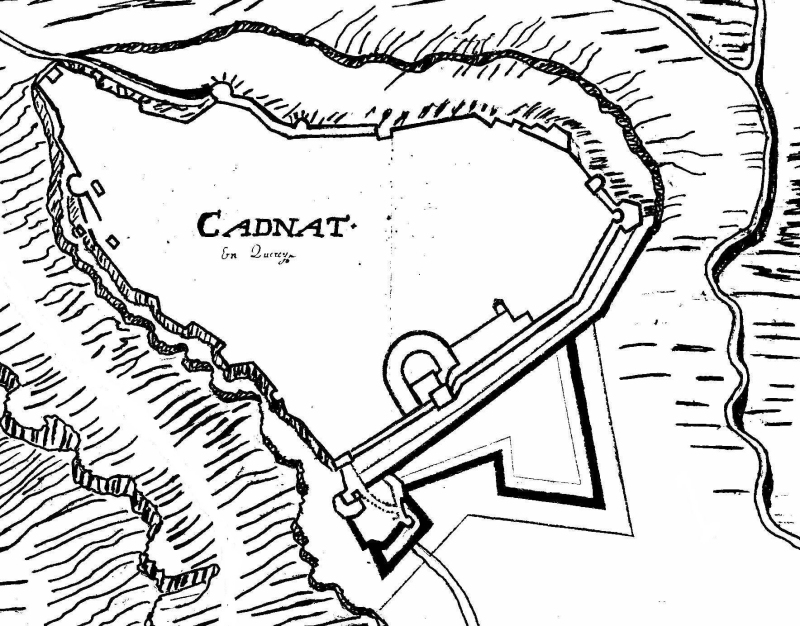 Les premières
défenses de Capdenac furent mises au jour en 1967 lors des tranchées de
conduites du GAZ de LACQ . Ces tranchées révélèrent la présence d’un mur
constitué de gros blocs de pierres, remontant à l’époque gauloise, au
vu des objets découverts sur place. Ce mur était précédé d’un immense
fossé. Les frères Champollion et leur ami Jacques-Antoine Delpon
avaient, en 1816, déjà fouillé cet ensemble, ils y trouvèrent de
nombreux objets antiques contemporains de la guerre des Gaules. Les
frères Champollion et Jacques-Antoine Delpon attestèrent lors de ces
travaux, que Capdenac correspondait parfaitement en tous points, à la
description du site d’Uxellodunum*, qui fut le dernier bastion gaulois à
résister à César, en 51 avant J.C. (voir livre VIII de la Guerre des
Gaules). Les premières
défenses de Capdenac furent mises au jour en 1967 lors des tranchées de
conduites du GAZ de LACQ . Ces tranchées révélèrent la présence d’un mur
constitué de gros blocs de pierres, remontant à l’époque gauloise, au
vu des objets découverts sur place. Ce mur était précédé d’un immense
fossé. Les frères Champollion et leur ami Jacques-Antoine Delpon
avaient, en 1816, déjà fouillé cet ensemble, ils y trouvèrent de
nombreux objets antiques contemporains de la guerre des Gaules. Les
frères Champollion et Jacques-Antoine Delpon attestèrent lors de ces
travaux, que Capdenac correspondait parfaitement en tous points, à la
description du site d’Uxellodunum*, qui fut le dernier bastion gaulois à
résister à César, en 51 avant J.C. (voir livre VIII de la Guerre des
Gaules).
Les premières
fortifications de Capdenac servaient donc à barrer ce passage de 100
mètres, par un grand mur précédé d’un fossé.
Ensuite, ce sont
les Romains qui transformèrent le système défensif de Capdenac, en
réduisant la superficie de la place. Ils reculèrent les fortifications,
et y inclurent une grande porte composée de deux tours circulaires, qui
fut démolie vers 1865 pour élargir le passage de la route.
Les fortifications
romaines semblent avoir été restaurées par les Wisigoths, qui y
apportèrent peu de modifications. L’évolution du système défensif de
Capdenac va avoir principalement lieu au XIIIème et XIVème siècle, et
donneront le plan élaboré dont nous allons voir le détail.
Le système mis en
place est cité en exemple dans plusieurs chartes, où il est même mentionné que Capdenac est la ville « la plus forte d’ici à Lyon ».
Les défenses
étaient donc composées de deux enceintes, séparées par un grand fossé.
Pour accéder à l’intérieure de la ville, il fallait passer par pas moins
de quatre portes et un pont-levis.
La première porte
La première porte
était située dans une sorte d’encoche dominée de tous côtés par les
remparts, du haut desquels les défenseurs pouvaient repousser les
assaillants.
La porte de César :
La porte de César
était le deuxième obstacle à franchir pour prendre la ville d’assaut.
Cette porte avait été conservée depuis l’époque antique, et inclue
dans le système défensif médiéval de Capdenac. Les deux larges tours
circulaires percées de meurtrières en défendaient l’accès. Comme nous
l’avons vu ce fantastique ouvrage fut démoli à la fin du XIXème siècle,
néanmoins, nous possédons un très beau croquis effectué par
Jacques-Joseph Champollion.
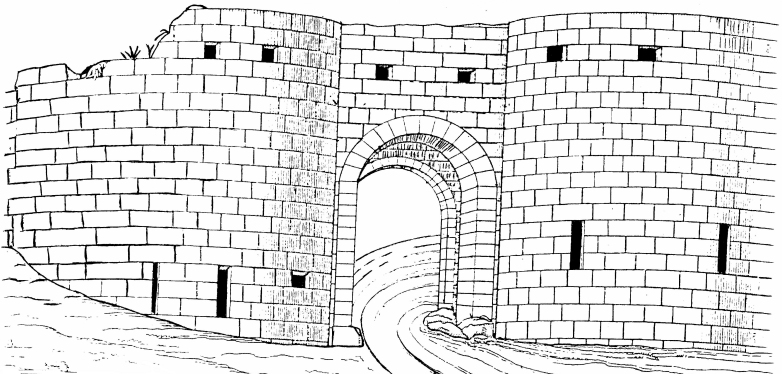
Croquis de la porte de César, réalisé par
Jacques-Joseph Champollion
La porte de Gergovie :
C’est la troisième
porte à franchir. Elle constituait avec la porte de César, une puissante
barbacane. Deux meurtrières, ainsi qu’un assommoir servant à déverser
divers projectiles ou liquides sur les assaillants sont encore visibles.
La barbacane avait pour but d’empêcher le maniement du bélier, en ne
procurant pas le recul nécessaire à la manipulation d’un tel instrument
d’assaut.
Le franchissement
d’une barbacane était très difficile, et pouvait causer la perte de
nombreux hommes.
Le pont-levis :
Une fois la
barbacane passée, la première enceinte de Capdenac était vaincue, les
défenseurs pouvaient regagner la seconde enceinte par un souterrain,
dont l’entrée est toujours visible dans le fossé.
La seconde enceinte
était défendue par un grand fossé creusé à même le roc. Pour franchir ce
fossé, un pont-levis fut aménagé, et lors d’un siège, celui-ci
constituait un obstacle majeur.
La porte Comtale :
Après avoir passé
trois portes et un pont-levis, un ultime ouvrage défensif barrait la route
aux assaillants, c’était la porte comtale, qui s’ouvre sur la rue de la
Peyrolerie. Cette dernière porte se trouvait proche de l’habitation du
comte qui commandait la ville d’où son nom.
La citadelle : Une fois la porte
Comtale franchie, les envahisseurs se trouvaient dans la cité, mais là
commençait un autre siège. Capdenac était en effet pourvu d’une
importante citadelle commandée par un donjon, qui domine toujours le
village, de sa terrasse crénelée.
La citadelle
possédait deux enceintes totalement indépendantes des défenses de la
ville. Pour déloger les derniers résistant, il fallait donc franchir les
deux portes des enceintes de la citadelle. Une fois les enceintes de
celle-ci franchies, il restait le donjon, ultime refuge de la ville.
Le donjon :
L’accès au donjon se faisait se faisait
par une porte du deuxième étage, celle-ci est encore intacte
aujourd’hui. On y montait par un escalier escamotable. Même une fois la
citadelle prise, la résistance pouvait continuer dans le donjon. Ce
n’est qu’une fois le donjon pris, que la reddition de Capdenac était
totale.
Un vaste réseau de souterrains servait
également à cacher des vivres et des armes, quelques portions furent
remises au jour, mais non explorées lors de divers travaux effectués
dans le village.
Portes Sud ou
Narbonnaise
Ces portes
disposées en barbacane constituaient le deuxième accès à la cité de
Capdenac. Le chemin qui les traverse n’est autre que la treizième voie
de César, importante voie romaine reliant Narbonne à Limoges. Cette voie
de communication fut pendant de très longs siècles très fréquentée, et on
nous rapporte une amusante anecdote à son sujet : « Ce fut sous
l’évêque Itier et Aymar, abbé de Saint-Martial de Limoges, qu’un
seigneur limousin appelé Simplicius, fit venir de Narbonne des pièces de
marbre pour orner cette église. On les fit passer par Capdenac, comme
étant la route la plus courte, et il est à noter que les soldats qui
gardaient la citadelle de cette petite ville abattirent un pan de
muraille pour les introduire dans l’enceinte de la cité. Le gouverneur
de cette place comptant pour peu de chose une brèche faite à un rempart,
quand il s’agissait de faire une bonne œuvre, en laissant passer des
colonnes de marbre destinées à l’embellissement de l’église que l’on
bâtissait en l’honneur de saint Martial. » On ajoute que « seule
une paire de petites vaches suffirent pour traverser le Lot, et gravir
la longue côte de Capdenac »
Capdenac ne fut
jamais attaqué sur son versant sud bien trop difficile d’accès.
Conclusion
Grâce à son
système défensif très élaboré, la vieille cité capdenacoise ne fut
jamais prise d’assaut. Capdenac connut néanmoins de nombreux sièges,
près d’une douzaine, au cours des siècles.
|
 |
 |
| Porte Sud |
Capdenac
sous la neige, 2005 |
*L’Association
Pour Uxellodunum à Capdenac reprend depuis 2002 les arguments des
diverses recherches qui ont défendu la thèse Capdenac-Uxellodunum. |